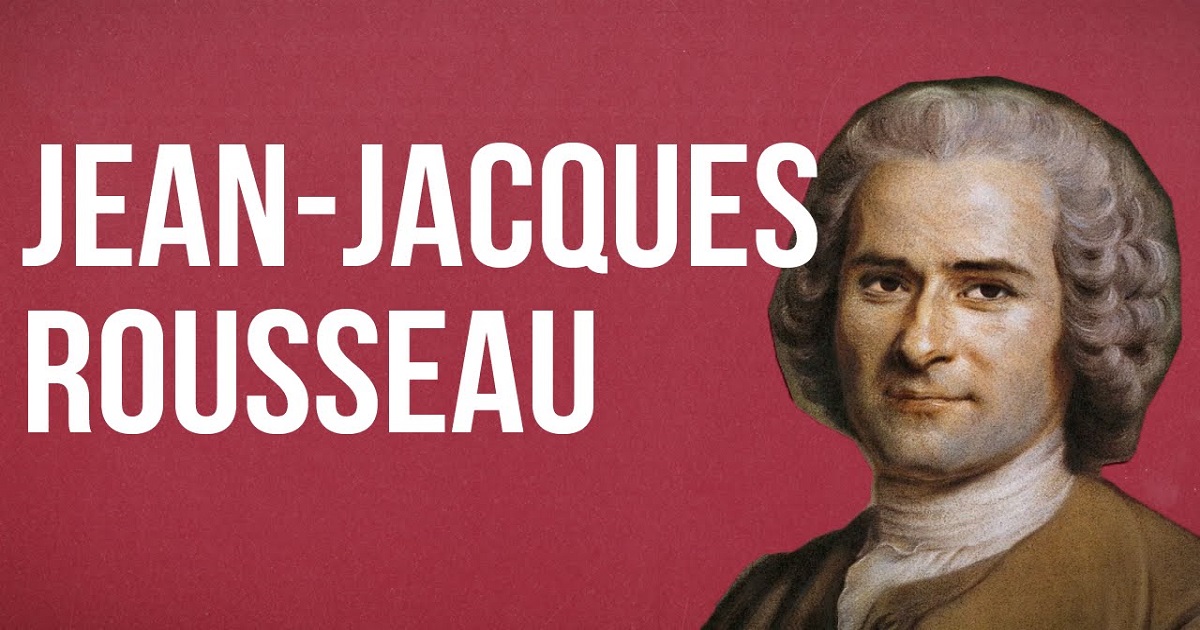Quote this article:
Fakoro Sountoura, Karim. “L’éthique rousseauiste : Le paradoxe de l’individualisme au cœur de la collectivité.” American Journal of French Studies, 2022.
Abstract:
This article focuses on Rousseauist ethics, which raises a problematic question relating to the paradox of individualism at the heart of society. Indeed, Rousseau cleverly discusses the virtues of the general will which embodies the power of the collectivity, while adopting a lifestyle devoted to the cult of individualism which manifests itself in a withdrawal from society. In addition, the minority and the individual appear in this paradigm as sacrificed for the benefit of the state, an observation made by Bruno Bernardi while criticizing the death penalty legitimized by Rousseau; and Hans Kelsen who incriminates the subversive submission of the individual and minorities to the relentless supremacy of the majority in the Rousseauist model. In this article, we have sought to analyze the Rousseauist articulation of this paradox in the light of the criticisms raised.
Keywords: Rousseau, ethics, individualism, collectivity, paradox

Université des Lettres et des Sciences humaines de Bamako (Mali)
L’œuvre de Rousseau a longtemps été lue comme une suite d’idées de tout ordre sans liens manifestes ni cohérence inhérente. Ce n’est qu’avec les travaux de Cassirer[1] que l’on a envisagé que Rousseau, auteur prolifique et éclectique, avait produit non seulement une œuvre solidaire dans ses fondements mais également une réflexion expansive sur la vie en société et le rôle que doit y tenir l’individu. Nous ne reviendrons naturellement que de manière très superficielle sur cet aspect unificateur de la pensée rousseauiste.
Dans le cadre de cette étude sur l’éthique rousseauiste, il nous est apparu opportun d’entendre le concept d’éthique comme l’ensemble des valeurs et des principes qui constituent la base et le fondement de tout système de pensée et de toute doctrine organisée. Entendre « éthique » d’une manière restrictive, c’est-à-dire dans son acception purement philosophique aurait obéré le développement et la compréhension des idées rousseauistes qui sont, par essence, éclectiques et arborescentes. De ce fait, pour résoudre le paradoxe soulevé par la tension entre l’individualisme et la collectivité chez Rousseau, nous avons décidé d’évoquer divers aspects de son œuvre comme sa pensée politique (qui est également un point d’observation important de ce paradoxe) critiquée par Kelsen qui a fondé un normativisme juridico-politique adopté par la plupart des démocraties dans le monde, sa pensée littéraire qui renforce et confirme ce paradoxe, puis sa pensée purement éthique, c’est-à-dire morale qui achoppe sur la question de la peine de mort que nous examinerons.
Ces questions nous intéressent parce qu’elles cristallisent, sans être évoquées dans les mêmes travaux, les réserves les plus sérieuses sur les contradictions inhérentes aux idées rousseauistes en dehors des accusations de totalitarisme dues à certains chercheurs[2] dont les théories ont été abandonnées depuis un demi-siècle. Néanmoins, sans conclure dans le même sens, Bruno Bernardi voit potentiellement dans la question de la peine de mort défendue ou au moins tolérée par l’auteur du Contrat Social le signe d’une désarticulation de la mécanique doctrinaire rousseauiste qui était censée pourvoir, à l’origine, à la conservation de chaque individu dans la société. D’un autre coté, mais toujours dans le même ordre d’idée, Kelsen et dans une moindre mesure Hannah Arendt reprochent à Rousseau la prééminence de la souveraineté populaire sur la liberté individuelle qui fonde sa pensée politique.
Or, la sensibilité rousseauiste que révèle son œuvre littéraire qui s’accommode d’un intimisme et d’un individualisme presque salvateurs tranche avec la rigueur toute jacobine avec laquelle le philosophe genevois assène l’autorité absolue de la souveraineté populaire dans sa doctrine politique. Nous tenterons de concentrer l’essentiel de nos efforts d’analyse sur ces aspects de la pensée rousseauiste, pour certains, peu commentés comme la problématique de la peine de mort développée dans le Contrat Social.
Notre réflexion portera sur toutes ces questions qui témoignent de ce point de rupture présumé dans la pensée rousseauiste. Toutefois, ce paradoxe qui naît de contradictions problématiques et apparentes signifie-t-il pour autant qu’il ne se justifie pas dans l’articulation de la doctrine rousseauiste ? Les critiques adressées au paradigme rousseauiste en rapport avec ces contradictions, malgré leur légitimité, sont-elles de nature à remettre en cause la cohérence de la pensée rousseauiste sur ces questions ?
Aussi, notre propos ne pourra être assimilé ni réduit à une tentative de légitimation de la dichotomie entre le bien-fondé des positions rousseauistes et l’unité de sa pensée. C’est la cohérence de la démonstration rousseauiste sur les problèmes soulevés qui retiendra notre attention et guidera notre démarche. L’on ne peut avoir la prétention de dissoudre ces difficultés ou d’en tirer des conclusions définitives et péremptoires, mais, au mieux, nous essayerons de rendre compte de la complexité et de l’actualité des points de vue rousseauistes sur les questions évoquées dans cette étude.
I. Opposition entre pensée littéraire et doctrine politique ?
La compréhension et la conservation de l’individu sont au cœur des préoccupations de Rousseau aussi bien dans son œuvre littéraire que politique. L’un des héritages les plus significatifs de l’auteur des Rêveries est très certainement la sensibilité qu’il revendique dans son rapport à la nature, et cette nouvelle sensibilité a conduit inéluctablement le Genevois à adopter une posture individualiste et intimiste qui fera date dans l’histoire des idées. Cette innovation spectaculaire fera des émules le siècle suivant au cœur de la révolution romantique. Bien avant déjà, Madame de Staël s’était émerveillée devant la sensibilité rousseauiste,[3] de même que Chateaubriand et Benjamin Constant qui se sont bien gardés de l’afficher ostensiblement pour des raisons que nous évoquerons plus tard dans nos propos.
René[4] de Chateaubriand et Oberman[5] de Senancour ne peuvent être vus que comme des alter ego du promeneur solitaire, ces personnages que certains critiques qualifiaient volontiers de préromantiques vont offrir à Rousseau et à son œuvre une légitimité légendaire qui marquera durablement les esprits. Ainsi, l’introspection et l’évocation de soi deviennent des leitmotive suffisants pour écrire, on a désormais le droit d’être égotiste[6] comme le disait Stendhal. Ce bouleversement opéré par notre auteur fait de son œuvre un point de bascule de la pensée moderne, c’est la naissance de l’individualisme[7] à la fois comme inspiration cathartique mais aussi comme élément de savoir être dans la société :
Tout ce qui m’est extérieur, m’est étranger désormais. Je n’ai plus en ce monde ni prochain, ni semblables, ni frères. Je suis sur la terre comme dans une planète étrangère où je serais tombé de celle que j’habitais. Si je reconnais autour de moi quelque chose, ce ne sont que des objets affligeants et déchirants pour mon cœur, et je ne peux jeter les yeux sur ce qui me touche et m’entoure sans y trouver toujours quelque sujet de dédain qui m’indigne, ou de douleur qui m’afflige. Écartons donc de mon esprit tous les pénibles objets dont je m’occuperais aussi douloureusement qu’inutilement. Seul pour le reste de ma vie, puisque je ne trouve qu’en moi la consolation, l’espérance et la paix, je ne dois ni ne veux plus m’occuper que de moi. C’est dans cet état que je reprends la suite de l’examen sévère et sincère que j’appelai jadis mes Confessions.[8]
Toutefois, il est à noter que même si Rousseau et ses personnages pratiquent assidûment l’individualisme, ils n’en ont jamais fait la promotion ouvertement, et cette subtilité sans doute assez peu commentée confère à l’individualisme rousseauiste un caractère intimiste innovant que l’on retrouve rarement chez les auteurs romantiques. Cette spécificité qui devait placer son œuvre sous le signe de l’intimité a été interprétée comme un désir de rejet de l’autre. D’ailleurs, Voltaire n’aura de cesse de décrier et d’incriminer chez Rousseau sa propension à l’individualisme et à la solitude. Ce trait de caractère agira a posteriori comme un marqueur génétique de la sensibilité romantique.
Il est vrai que l’incipit des Confessions impulse une révolution copernicienne dans le monde des lettres, de la pensée et des idées, à telle enseigne que l’autobiographie devient un genre à part entière dans la littérature. L’individualisme rousseauiste nait dans un contexte de libération de l’homme et de sa pensée, le siècle des Lumières a promu l’individu comme objet d’intérêt à l’exclusion ou au moins à concurrence de l’Etre suprême. Ainsi, à l’instar de Rousseau, l’homme peut revendiquer sa spécificité, son unicité. Désormais, on a le droit à la différence, et l’on se délecte même d’étaler à la surface ses émotions et ses états d’âme comme autant de preuves à la fois de singularité, mais aussi d’authenticité. De ce fait, il est évident qu’avec l’auteur des Confessions, comme d’ailleurs avec le promeneur solitaire, que l’altérité est la condition de la liberté.[9] Il apparait nécessairement que Rousseau est l’un des tout premiers précurseurs de l’écriture autobiographique, intimiste et individualiste moderne.
A contrario, l’auteur du Contrat social est paradoxalement resté dans l’esprit de nombreux observateurs passés et contemporains comme l’instigateur sulfureux d’une doctrine politique construite principalement autour de l’idée de la puissance inextinguible de la collectivité. En effet, l’œuvre politique du philosophe met en avant la toute-puissance de la collectivité qui s’incarne dans la volonté générale. Puisqu’aucun individu n’est supérieur à aucun autre, et qu’il est inimaginable de confier le destin commun à une personne qui agira à sa guise, Rousseau propose donc une convention dans laquelle chaque contractant renonce à une partie de sa liberté pour se placer sous l’empire de la loi qui devient la norme suprême dont le respect oblige sans exception chaque individu au sein de la collectivité. Ce dispositif n’est pas en lui-même une innovation – Locke promouvait déjà la souveraineté du peuple[10] – cependant il doit sa spécificité ou même sa radicalité à la manière dont le paradigme rousseauiste se déploie en faisant de la cohésion du corps politique l’élément essentiel de sa mise en œuvre.
C’est ainsi que Rousseau envisage la République comme l’expression de la volonté populaire qui découle de la participation de chaque citoyen aux délibérations. Toutefois, là où transparait l’intransigeance de ce système, c’est la sacralisation du fait majoritaire[11] qui, en plus d’être irrévocable, revêt un caractère incoercible. L’adhésion péremptoire à la religion civile qui oblige chaque citoyen, ainsi que la faculté que s’autorise le Souverain de forcer les individus rétifs à être libres, ne sont pas des dispositifs de nature à permettre l’expression spontanée des voix dissonantes au sein de la République.
Et c’est justement en raison de cette prééminence suprême de la souveraineté populaire que Benjamin Constant combattra farouchement ce modèle républicain. En fait, ce dernier considère, outre sa conviction libérale, que, de même qu’il ne sied pas qu’un seul individu prédomine en tout dans la communauté, qu’il est tout autant pernicieux qu’un groupe d’individus, fut-il majoritaire, s’arroge le droit de décider sans compromis de toutes les orientations de la société. On aboutit donc, ne serait-ce que théoriquement, à une société où la collectivité écrase le citoyen et le prive de son autonomie.
Parmi les critiques potentielles de la philosophie politique rousseauiste basée sur la prédominance de la volonté générale, nous pouvons évoquer le normativisme kelsénien. En effet, Kelsen, juriste austro-américain, fait du parlement donc de la représentation, le champ d’affrontement des intérêts opposés en vue d’atteindre un compromis qui privilégie ce qui unit les positions et exclut ce qui les éloigne. Ce résultat constituera la preuve du fonctionnement de la démocratie, en ce sens que toutes les sensibilités de la république s’y expriment, d’autant plus que Kelsen introduit l’idée d’un vote à la majorité qualifiée pour protéger les droits constitutionnels de la minorité, d’où l’apparition chez lui du principe « majoritaire-minoritaire[12]». Il est difficile de ne pas convenir de la pertinence d’un tel constat, d’ailleurs, Benjamin Constant fait la même remarque à propos de l’absolutisme de la volonté générale promu par Rousseau, puisqu’il observe qu’il est « un mal en quelques mains qu’on le place […] Au point où commencent l’indépendance et l’existence individuelle, s’arrête la juridiction de cette souveraineté. [13] »
Rousseau est à l’origine de l’écriture intimiste moderne, il en fait même une condition de la liberté humaine par la promotion contingente d’un individualisme désinhibant et cathartique ; et, en même temps, sa doctrine politique est fortement décriée en raison de la toute-puissance de la collectivité qu’elle institue au détriment du citoyen. Alors, que devons-nous retenir de ce paradoxe rousseauiste qui apparait insoluble au premier abord ? Par quelle logique, pourrions-nous réconcilier individualisme et collectivité dans l’entendement rousseauiste ?
Ces interrogations sont d’autant plus pertinentes qu’elles conditionnent la compréhension globale de l’œuvre de Rousseau qui continue de susciter controverses et contestations. A notre sens, il apparait pourtant qu’une logique sous-tend cette tension problématique qui ne pourra être résolue qu’à partir d’un certain nombre de précisions et d’analyses qui mettront aux prises des concepts rousseauistes à même d’élucider ces contradictions apparentes. Ainsi pour comprendre l’articulation entre l’individualisme et la collectivité chez Rousseau, il nous est apparu nécessaire de déplacer les débats vers l’opposition entre intérêt commun et intérêt particulier qui reproduit sensiblement le même antagonisme que celui qui constitue notre sujet. Si la défense intransigeante de l’intérêt commun est unanimement perçue comme un trait caractéristique du modèle rousseauiste, il n’en va pas de même de l’intérêt particulier – ou privé – qui est régulièrement décrit comme un principe honni de Rousseau, l’individu n’ayant aucune autonomie propre au sein de ce système.
Nous pensons que contrairement à ce constat, l’auteur du Contrat social accorde certes la priorité à l’intérêt commun, mais il n’en est pas moins soucieux de la défense de la liberté et des intérêts particuliers même si des auteurs – comme Hanna Arendt qui combattait férocement l’idée d’une souveraineté transcendante[14] qui servirait de socle à la prise de décision politique dans la collectivité – ne partageaient pas nécessairement notre opinion. Toutefois, de nombreux passages des écrits de Rousseau apportent un démenti au caractère supposément arbitraire ou liberticide de sa doctrine. Ces passages, loin d’être exceptionnels, constituent même, à bien des égards, des points essentiels de compréhension de l’œuvre de Rousseau, à telle enseigne qu’il est curieux que beaucoup d’observateurs aient choisi de sous-interpréter ou même d’ignorer ces points qui agissaient pourtant comme des garde-fous et des rappels que l’auteur faisait à ses lecteurs pour leur signifier son attachement à la République et à ses idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité.
Rousseau ne conçoit la République que comme un ensemble cohérent et puissant dont le but ultime est la conservation des citoyens. Et cette conservation ne peut intervenir que dans un cadre commun et collectif puisqu’il explique que, pris individuellement, les citoyens sont démunis et faibles devant l’adversité. Ils ne deviennent forts que dans la collectivité d’où l’idée que l’intérêt commun est d’abord constitué des intérêts particuliers des citoyens qui, nécessairement, se croisent et se confondent pour l’essentiel. De ce fait, il apparait que l’intérêt commun rousseauiste ne peut-être que l’émanation des intérêts particuliers combinés et convergents des individus.
De même, la volonté générale ne peut se concevoir que comme la rencontre de volontés particulières dont la réunion et l’identité donnent corps à une volonté suprême dans laquelle se reconnait la collectivité ou au moins une majorité de citoyens, d’où le système tire sa légitimité. D’ailleurs, dans La Constitution de Corse, Rousseauindique clairement qu’aucune loi ne saurait spolier un particulier de la moindre parcelle de son bien, seul le surplus acquis illégitimement doit être confisqué au profit de la collectivité,[15]ce qui constitue une garantie contre l’arbitraire à la fois pour le citoyen, mais aussi pour la collectivité.
En fait, pour le philosophe genevois, l’intérêt particulier et l’intérêt commun sont imbriqués et inextricables puisqu’ils lui semblent être les deux facettes d’une même médaille qui représente la République. S’il ne disserte pas autant sur l’intérêt particulier que sur l’intérêt commun, il ne pense pas moins qu’il est impossible de défendre la collectivité sans défendre les particuliers. Puisqu’il observe dans une version antérieure du Contrat social « qu’on ne peut travailler pour autrui sans travailler en même temps pour soi [16]». Cette manière d’envisager les intérêts collectif et particulier dans le cadre des relations intrasociales rappelle étrangement la main invisible[17] d’Adam Smith qui postule que l’individu pensant agir exclusivement pour ses intérêts propres travaille, en fait, pour la collectivité. Si les études smithiennes tendent à tempérer et à contester l’usage extensif de ce concept qui renvoie abusivement, dans le domaine économique, à l’autorégulation et à la dérèglementation, il semble que son acception première qui relie la quête de l’intérêt particulier à celle de l’intérêt commun ne peut utilement être niée – comme peuvent en attester les références ci-dessous. Il devient évident que le professeur de philosophie morale écossais fait le même constant que Rousseau sur le caractère imbriqué, entremêlé et solidaire des intérêts particulier et collectif dans la République, le second découlant nécessairement du premier.
Une fois ce malentendu sur la tension problématique entre l’intérêt commun et l’intérêt particulier dissipé – ne serait-ce que partiellement – il reste une autre difficulté qu’il faut examiner du point de vue de l’éthique rousseauiste. Bruno Bernardi questionne le positionnement de Rousseau sur le problème de la peine de mort. Le penseur genevois envisagerait la peine de mort comme à la fois une sanction contre le citoyen qui a violé le contrat social, mais également comme un acte de guerre du Souverain au détriment du citoyen. En tout cas, c’est sous cet angle que Bruno Bernardi analyse l’inclination de Rousseau à légitimer la peine de mort puisqu’il lui apparait que la prison pourrait suffire à circonscrire le danger que constitue cet individu pour la collectivité.[18] Il s’appuie sur ce point pour développer une réflexion qui laisse entrevoir une dimension sacrificielle de l’individu devant la suprématie de la volonté populaire, et pour lui, c’est cette dimension sacrificielle du citoyen qui caractérise le paradigme rousseauiste et se révèle être sa plus grande gageure.
II. La peine de mort : Une guerre de l’Etat contre l’individu ?
Pour Bruno Bernardi, la peine de mort ainsi justifiée par Rousseau soulève une question fondamentale qui relie les trois difficultés que semble receler une telle réflexion, en l’occurrence, la compatibilité entre la conservation de soi, celle du Souverain et l’idée selon laquelle « le traité social a pour fin la conservation des contractants ». Il lui apparait donc que la peine de mort, que Rousseau juge nécessaire pour faire « périr » un contractant qui constituerait un danger pour la collectivité, induit une contradiction fondamentale avec la fin escomptée du traité social. Il s’ensuit donc que la peine de mort viole l’esprit même du paradigme rousseauiste dont l’ambition semble être, du moins dans le Contrat social, de concilier et de rendre viables les trois gageures majeures susmentionnées. Le chercheur conclut en ces termes :
Au terme de cette étude, on peut constater, mais ce n’était pas le but, que toutes les difficultés suscitées par ce chapitre n’ont pas été levées. En ce qui concerne le point même de la peine de mort, il est possible d’avancer que la logique propre de l’argumentation de Rousseau devrait le conduire à en récuser la notion même : parce qu’elle prend acte de la rupture du pacte social et redouble cette rupture, la peine de mort porte en elle la dissolution du corps politique. Elle ne saurait être un acte de justice, tout au plus un acte de guerre […] il me semble avoir mis en évidence ce qui pourrait bien être la clé de voûte et donc le lieu de la contrainte maximale de sa pensée. La compatibilité du principe de la conservation de soi et de celui de la souveraineté dépend de ce troisième principe qui veut que « le traité social a pour fin la conservation des contractants ». Or, on l’a vu, la consistance de ce troisième principe est toute entière suspendue à ce que l’on puisse faire coïncider la conservation des contractants, ou des particuliers, et celle du Souverain, ou de la communauté. Tout l’effort du Contrat social n’est-il pas de montrer que cette coïncidence est pensable et de mesurer combien elle est difficile et précaire ?[19]
Les réserves ainsi exprimées, malgré leur congruence, omettent une subtilité rousseauiste que Bruno Bernardi ne commente guère. En effet, Rousseau, avant que la peine capitale ne soit requise contre un individu, précise qu’il subit cette fin moins comme citoyen qu’ennemi. Et cette idée est essentielle puisqu’elle manifeste un basculement du statut de citoyen à celui d’ennemi de la collectivité ; et, ce basculement s’opère par le biais des « procédures, d’un jugement qui sont les preuves et la déclaration qu’il a rompu le traité social[20] ». Cette étape permet à Rousseau de désengager la communauté du pacte qui le relie à cet individu puisque le respect du pacte n’oblige l’Etat, et ne vaut qu’autant que le contractant ne rompe en premier le traité social.[21] Or, une fois que les procédures, le jugement et les déclarations ont établi la culpabilité de l’individu, il n’est plus membre de l’Etat,[22]et ce dernier cesse immédiatement de lui devoir les soins ayant été à la base du contrat social les liant. Ainsi la peine de mort ne peut plus s’analyser, comme le postule Bruno Bernardi, comme une rupture ou un dédoublement de rupture du pacte social, mais tout simplement comme une application stricte de ses termes.
On pourrait aussi faire observer que si Rousseau est favorable à la peine de mort, ce n’est ni pour déclarer la guerre au citoyen incriminé et encore moins pour susciter la crainte, mais uniquement pour défendre la collectivité jusqu’à la dernière extrémité contre toute forme de contingence.[23] D’ailleurs, la neuvième lettre écrite de la montagne annonce d’un ton ferme et sec que les mesures à prendre par les magistrats genevois pour protéger les citoyens doivent l’être « non pas pour sauver le coupable, mais pour garantir les innocents [24]».
Il apparait même à la lecture du chapitre V du livre II du Contrat Social que Rousseau prend soin de détailler sa conception du droit de vie et de mort. En effet, il fait dériver le droit de condamner à mort du droit de la guerre qui ne doit être interprété que comme une confrontation « accidentelle » entre citoyens de différents pays puisqu’un Etat ne peut entrer en guerre contre un individu. De même que le droit de la guerre impose très souvent qu’un Etat disparaisse au profit d’un autre, Rousseau justifie la condamnation à mort d’un criminel par le danger qu’il peut constituer pour la collectivité. Cette subtilité transparait clairement dans ce chapitre avec une volonté remarquée de circonspection de la part de Rousseau :
On n’a droit de faire mourir, même pour l’exemple, que celui qu’on ne peut conserver sans danger.[25]
La négation restrictive utilisée par Rousseau renvoie aux limites qu’il assigne à la peine de mort qui ne doit être envisagée qu’en dernière extrémité contre le citoyen ayant assumé et signifié sa volonté de nuire et de détruire le contrat social. Mais, qu’en est-il de la légitimité même du Souverain à disposer de la vie des particuliers qui le composent ? C’est le principal point d’achoppement entre Bruno Bernardi et la logique sacrificielle rousseauiste qu’il rechigne à légitimer. En effet, Rousseau explique que si la vie ne peut être vue que comme un don inconditionnel de la nature, cette conception n’était valable qu’autant que l’homme vivait à l’état de nature puisqu’alors aucune entrave ne limitait ses droits si ce n’était sa force physique. Il en est tout autrement dans le cadre du contrat social.
L’institution de la loi bouleverse les droits et les devoirs de l’individu qui est désormais tenu de s’associer à la collectivité pour assurer sa sécurité et garantir sa vie. La puissance publique agit donc à la fois comme le protecteur du citoyen, mais aussi comme l’institution qui peut disposer de sa vie. L’argument rousseauiste consiste à faire remarquer que si le citoyen peut jouir de sa vie, c’est parce que le Souverain l’a garantie et donc, qu’il ne doit sa vie en société qu’à la collectivité, ce qui veut dire que l’Etat peut la lui enlever si le citoyen constitue par la gravité de son comportement un danger pour les autres contractants dont la protection oblige également la collectivité.
L’Etat ne peut conserver les contractants que s’ils acceptent les termes du pacte et s’y tiennent. La collectivité, dans l’entendement rousseauiste, ne s’est pas donnée comme objectif de sauver – métaphysiquement – les citoyens ou de les réhabiliter mais uniquement de les protéger contre les aléas de l’existence en société. Pour Rousseau, le salut de l’individu, donc du citoyen passe moins par l’Etat que par lui-même, c’est en cela que la notion de perfectibilité [26]nous interpelle car cette idée permet à l’homme, en conformité avec son libre arbitre, de choisir et de mesurer les conséquences de ses actes et, in fine, de les assumer sans jamais tenir la collectivité responsable de ses choix, les termes du pacte social étant suffisamment explicites pour arguer du contraire. Même si le pessimisme rousseauiste imprègne profondément cette notion, elle est également le lieu d’un choix optimiste pour l’avenir de l’homme, inséré par défaut, dans une collectivité dont les valeurs et les règles qui constituent son bagage historique et social doivent lui permettre de ne point s’éloigner des lois qui président à son séjour dans cette collectivité.
Ainsi le cercle vertueux de la conservation de soi, du Souverain et du contrat social qui a pour fin la conservation des contractants se révèle cohérent, dès l’instant où l’on resitue et restitue les termes du pacte social en prenant soin de détailler le processus par lequel l’individu est déchu de son titre de citoyen dans la réflexion rousseauiste. Nonobstant cette démonstration, la peine de mort, dans l’esprit qui préside à sa légitimation, est perçue de manière biaisée par Bruno Bernardi qui ne peut envisager un Etat qui enlève la vie à des individus qu’il avait la charge de conserver. Cela s’entend et peut s’inscrire dans une nouvelle tradition philosophique. Il aurait fallu, à notre avis, que Bruno Bernardi fondât sa critique – ne serait-ce qu’en partie – plutôt sur l’évolution philosophique et juridique des droits de l’Homme qu’exclusivement sur la vision philosophique rousseauiste qui repose certes sur une réponse radicale, mais cohérente dans son articulation.
C’est justement cette même approche juridique que développe Kelsen pour remettre en cause le fondement éthico-politique même de la doctrine rousseauiste qui en appelle toujours à la toute-puissance de la collectivité pour dépasser la dialectique intérêt commun-intérêt particulier. Le juriste promeut une vision du débat politique qui tend à ériger la protection des droits des individus et des minorités comme une nécessité et une fin qu’il se propose d’atteindre en instituant des normes juridiques à même de contraindre la collectivité à observer des règles qui garantissent la prise en compte d’opinions et d’intérêts minoritaires.
III. Kelsen, vigie des droits politiques de l’individu et des minorités
De même, ne pourrions-nous pas objecter à Kelsen, que même si la minorité doit être entendue, qu’il serait contre-nature de donner un pouvoir de décision ou de blocage à cette minorité ? En effet, aucune république, aucune démocratie ne saurait reposer sur le principe du gouvernement par la minorité, le fait majoritaire étant l’incarnation même de la volonté populaire. On ne peut passer d’un régime supposément « totalitaire » opprimant les voix minoritaires en allant vers un système où la majorité serait appelée à se soumettre sans réserve aux desideratas d’un groupe minoritaire.[27] Renaud Baumert met en exergue cette faille dans la critique kelsénienne de la volonté générale rousseauiste. Il lui apparait que Kelsen reproche à Rousseau d’avoir entretenu l’illusion d’une liberté quasi-totale en société comme à l’état de nature. Or Kelsen explique que la multiplication des intérêts dans la collectivité induit nécessairement une domination ou une subordination sans réserves des opinions minoritaires au diktat de la majorité.
La possibilité d’offrir un pouvoir de blocage à la minorité dans le vote des lois ordinaires se relevant rédhibitoires et contraires aux contraintes liées à la liberté politique qu’il défend, Kelsen se résout à reconnaitre que ce pouvoir de blocage ne peut être utilisé que lors de consultations constitutionnelles. On constate aisément que Kelsen se heurte manifestement, lui aussi, au paradoxe rousseauiste qui impose une solution médiane ou un arbitrage entre les intérêts de l’individu et ceux de la collectivité dans la société politique. Aucun modèle de défense absolue du citoyen ou de la collectivité ne semble exempt d’écueils systémiques.
Les médiations kelséniennes au parlement qui tendent à associer les voix minoritaires à la prise de décision correspondent parfaitement à l’idée que Rousseau se fait de la souveraineté incoercible du peuple. Une loi ne devient une norme contraignante que si elle a été prise après la délibération du peuple réuni dans sa totalité, ce qui suppose que chaque citoyen a exprimé ses opinions, même si ne seront retenues in fine que les opinions les plus convergentes[28] au sein de l’assemblée, toutes les opinions particulières ne pouvant être satisfaites. De plus, Kelsen n’envisage le parlement que comme un lieu où s’affrontent des logiques de partis, là où Rousseau ne considère que des citoyens uniquement mus par leurs intérêts propres loin des calculs politiques qui confinent souvent à un panurgisme corporatiste.
En effet, l’idée que la formation de groupes d’intérêt politique apporte une garantie aux minorités est critiquable. C’est dans cette différence conceptuelle qu’il faut rechercher l’origine des dissensions qui subsistent entre le pouvoir souverain rousseauiste dans la démocratie et la nécessité des partis dans le jeu politique selon Kelsen. Pour le philosophe, les associations[29]induisent un détournement du citoyen de ses volontés authentiques pour le soumettre à la quête de celles de son parti, et quand les partis se multiplient, les volontés particulières – individuelles – diminuent puisque les intérêts des partis phagocytent, annihilent et se substituent à ceux des citoyens.
Il en ressort que la volonté générale dans une telle configuration n’est, en réalité, qu’une somme de volontés particulières dont les objets sont objectivement étrangers à l’intérêt commun. Or, tout l’effort de Rousseau porte sur la nécessité de favoriser l’expression spontanée de la volonté des citoyens sans interférence, gage de l’authenticité à la fois de la volonté générale et de la rectitude des délibérations du Souverain. Ce qui le pousse à préciser :
« Il importe pour avoir bien l’énoncé de la volonté générale qu’il n’y ait pas de société partielle dans l’Etat et que chaque Citoyen n’opine que d’après lui ».[30]
Cependant, la radicalité conceptuelle rousseauiste qui perce sous cette quête d’authenticité pose quelques difficultés que le juriste relève, et dont il ne pouvait faire l’économie de la critique, puisque son modèle fonctionnel est antinomique de celui de Rousseau. Kelsen, ayant vécu sous un régime totalitaire en Europe où les minorités étaient persécutées, perçoit clairement que le modèle rousseauiste peut receler des failles qui obèrent dramatiquement les libertés de la minorité. Toute sa théorie des normes juridiques et sa ferveur dans la défense de ces minorités – ethniques ou sociales – qui deviennent de facto des minorités politiques, sont imprégnées de cette expérience traumatisante de la domination outrageuse et liberticide de la majorité.
Ainsi se justifie le parlementarisme kelsénien qui fait écho à la critique déjà ancienne de l’autorité absolue de la volonté générale incriminée par Benjamin Constant. Pour prévenir cet écueil, la formation de partis politiques chargés de défendre chaque intérêt particulier – donc chaque minorité – semble être la priorité de Kelsen pour empêcher la suprématie subversive de la majorité sur les minorités.[31] Cette précaution est d’autant plus salutaire que la démocratie représentative moderne d’essence libérale ne peut être appréhendée que comme une manifestation des préventions kelséniennes dont la pertinence le dispute à la nécessité au sein de la société politique moderne.
Il s’ensuit qu’il est délicat de vouloir analyser le modèle rousseauiste à l’aune de la conception démocratique kelsénienne puisque malgré une nette convergence, leurs deux perspectives s’entrechoquent sur le degré d’élasticité rédhibitoire de liberté pour qu’une démocratie puisse conserver les citoyens dans l’absolu. Quand Rousseau prône l’authenticité des sentiments – naturels – des citoyens concourant à la formation d’une volonté générale forte et droite ; Kelsen, quant à lui, préfère une démocratie où la volonté générale, loin d’être absolue, se formerait par l’entremise des partis, beaucoup plus à même de défendre les intérêts des particuliers et des minorités.
Si Rousseau donne l’impression de faire peu de cas des intérêts particuliers dans son système, il demeure fermement attaché à leur défense tant qu’ils n’entrent pas en conflit avec l’intérêt commun dont la réalisation ne peut que conduire à la satisfaction de ces mêmes intérêts particuliers, ne serait-ce qu’à minima. Toutefois, la radicalité objective rousseauiste est une constante qui s’exprime dès lors que le Genevois est aux prises à des contradictions entre ses convictions profondes et le principe de réalité qui obère souvent la pertinence de ses observations. Nous envisageons ce concept comme un réflexe méthodologique né d’un conservatisme doctrinal qui se déploie quasi instantanément et inconsciemment dès lors que Rousseau anticipe les difficultés qui peuvent naître de ses démonstrations.
Ce qui est en cause, ce qui obsède le philosophe, c’est l’efficience et la cohérence de son paradigme qu’il veut transparent, ceci explique aussi la grande pédagogie dont il use pour expliciter ses vues sur les questions incidentes. Ce réflexe semble être le corollaire de l’acrimonie particulière que vouaient d’autres penseurs majeurs[32] de l’époque à ses idées. La radicalité rousseauiste ne repose pas, dans l’absolu, sur des fondements idéologiques – comme on peut le remarquer très souvent-, mais elle est basée sur un pragmatisme guidé par la nécessité de tenir objectivement compte des failles de son système dont l’efficacité et la pertinence l’emportent souvent sur la cohérence globale de son œuvre. Cette radicalité objective est en marche quand Rousseau défend la peine de mort alors même qu’il est « humain à l’excès, est trop sensible à leurs peines [Les hommes], s’affecte autant des maux qu’ils se font entre eux que de ceux qu’ils lui font à lui-même.»[33]
IV. Qu’en est-il des contradictions rousseauistes ?
Ayant compris que son paradigme présente quelques faiblesses quant à son rejet de l’autonomie originelle des individus, Rousseau réagit en faisant un écart conceptuel radical à même de sauvegarder la pertinence pratique de son modèle tout en fourbissant ses arguments contre ses détracteurs. C’est toujours cette même radicalité objective qui est à l’œuvre lorsque Rousseau s’oppose à la représentation et sanctifie la volonté générale tout en adoptant un mode de vie voué à la pratique d’un individualisme farouche qui se manifeste par une recherche assumée de la solitude et un rejet remarquable des sociabilités. Elle est également à l’œuvre quand Rousseau prétend forcer un individu à être libre en l’amenant à suivre de manière coercitive le sens de la volonté générale.[34]
Ce que l’on doit retenir pour comprendre le sens véritable de ces contradictions, c’est que chez Rousseau les contradictions – apparentes – n’en sont jamais, en réalité. Pour percer cette énigme, il faut accéder à un autre niveau de compréhension de l’œuvre du philosophe genevois qui met au jour des arguments et des réflexions qui deviennent arborescents dès que les premières critiques pertinentes se présentent à ses paradigmes, même s’il défend ardemment, malgré tout, l’unité de son œuvre. Claude Habib précise à ce propos :
Rousseau défend farouchement la cohérence de son œuvre, mais on peut dire aussi qu’il accueille le terme de contradiction et qu’il autorise le thème, cela de trois façons différentes. Tout d’abord, bien sûr, il l’admet sous l’angle de l’apparence, il y a dans ce qu’il écrit des apparences de contradictions dont ses ennemis profitent. Il lui fait place, d’une autre manière, par un motif tiré de sa psychologie : son caractère est tel qu’il donne prise à ses adversaires par des contradictions qui cette fois peuvent être davantage que des apparences : des excès, des imprudences. Enfin, il fait droit au thème pour une raison logique, et dans ce troisième cas, les contradictions verbales deviennent quasiment nécessaires […] il s’est engouffré dans ce risque spécifique : dire avec trop de force, ne pas suffisamment mesurer son propos. En insistant démesurément sur tel aspect d’un phénomène, il court le risque d’apparaitre contradictoire s’il retourne plus tard au même phénomène, en l’examinant sous un autre jour, pour un autre de ses aspects.[35]
En définitive, ce qui se présentait comme un paradoxe rousseauiste se révèle finalement être une problématique d’actualité. En effet, jamais, la vie privée et l’intérêt particulier n’ont été autant revendiqués et défendus qu’aujourd’hui comme valeurs et vecteurs de liberté. Jamais le fait majoritaire n’a été aussi déterminant dans la gestion des affaires publiques, notamment en politique. Et l’individu moderne cultive sa spécificité, met en scène son authenticité comme le faisait le promeneur solitaire, mais il reste largement tributaire des vicissitudes politiques qui dénotent toujours de la prééminence de la collectivité.
La position de Rousseau sur la question de la peine de mort qui peut heurter certaines mœurs actuelles révèle encore et toujours la problématique des arbitrages entre l’intérêt de l’individu et celui de la collectivité. Cependant, la même question revient dans beaucoup de débats publics sous une autre forme, notamment avec l’usage des nouvelles technologies dans le cadre du maintien de l’ordre et de la sécurité. La protection des citoyens contre les velléités de nuisance diffuses induit aujourd’hui l’idée qu’il faille faire quelques concessions sur la préservation de la vie privée des individus. Ainsi, le paradoxe rousseauiste fait une incursion remarquée dans le monde moderne en nous interrogeant sur l’éthique de nos sociétés. En effet, la seule question qui importe sur ce sujet précis et sur l’ensemble des problématiques soulevées dans nos propos est la suivante : La quête de l’intérêt collectif vaut-elle que l’on renonce systématiquement à nos intérêts privés ?
Comme on l’a vu, la réponse de Rousseau à cette question procède de l’articulation de son concept d’intérêt commun qui se construit par la convergence des intérêts privés. Ces deux valeurs imbriquées imposent l’idée qu’aucune renonciation impérative n’est nécessaire puisque l’intérêt commun des citoyens ne peut être que l’émanation de leurs intérêts privés. Ce compromis rousseauiste rappelle que l’intérêt privé ne peut que s’exprimer par le biais de l’intérêt commun, les membres de la collectivité partageant en général les mêmes préoccupations devant un problème posé.
La gravité de cette question nous instruit également de concéder au rousseauisme l’adéquation d’une délibération souveraine au-delà de la représentation pour décider des arbitrages entre l’intérêt commun et l’intérêt privé. Par ailleurs, il semble inconcevable que les citoyens délibèrent souverainement et aliènent, dans le même mouvement, leurs propres libertés.
Enfin, le paradoxe, né des contradictions évoquées, même s’il peut opacifier et obérer la transparence de la mécanique rousseauiste, ne peut guère être conçu comme un élément de désarticulation de sa pensée. Cependant, il conduit le philosophe à radicaliser objectivement son discours dans une surenchère pouvant être perçue comme dogmatique. Les contradictions chez Rousseau sont, dans la plupart des cas, la manifestation d’un réflexe de défense de son paradigme comme pour faire contrepoids à son enthousiasme évocatoire et à la complexité de son caractère qui influent fortement sur le degré de précision de ses idées. Ce que ses contradicteurs n’omettent que rarement de relever et d’objectiver.
[1] Lire Cassirer, Ernst. Le problème Jean-Jacques Rousseau, Paris, Fayard/Pluriel, 2010.
[2] LireTalmon, Jacob. Les origines de la démocratie totalitaire, Paris, Calmann-Lévy, 1966.
[3] Lire de Staël, Germaine. Lettres sur les écrits et le caractère de Jean-Jacques Rousseau, Paris, Editions Paléo, 2014.
[4]Chateaubriand, Atala- René, Paris, Ed. Flammarion, 1964, p. 158-159
[5] de Senancour, Etienne, Obermann, Paris, Ed. Champion, 2003, p. 219-220
[6] Voir Stendhal, Souvenirs d’égotisme, Paris, Gallimard, 1983.
[7] L’incipit des Confessions affiche l’une des toutes premières fois la volonté d’un auteur de faire valoir et de revendiquer sa singularité comme motivation poétique, c’est-à-dire l’avènement d’un moi qui s’inscrit dans un rapport d’exclusion de l’autre, du public et même du lecteur. Ce qui était une entreprise osée, mais la postérité de l’œuvre renforce le rôle de précurseur de la pensée romantique moderne de Rousseau.
[8]Rousseau, Jean-Jacques. Première promenade des Rêveries du promeneur solitaire, dans Dialogues, Rêveries du promeneur solitaire, Correspondance, Paris, Librairie Larousse, 1972.
[9] La liberté ne peut s’envisager en société que dans le rapport aux autres, ma singularité n’a de sens que parce que l’autre existe et n’est pas moi, et je ne peux objectiver ma liberté qu’en imaginant ses limites qui touchent nécessairement à l’existence des autres.
[10] Le peuple seul peut décider de la forme de la république, en instituant le législatif et en désignant ceux à qui il sera confié. Et lorsque le peuple a dit : « Nous nous soumettrons aux règles faites par telles personnes, et nous serons gouvernés par les lois qu’elles feront suivant telle forme de gouvernement », personne ne peut plus dire que d’autres personnes auront à faire des lois pour ce peuple ; et le peuple lui-même ne peut être tenu par d’autres lois que celles qui auront été édictées par les hommes qu’il a choisis et autorisés à faire des lois pour lui. Le pouvoir du législatif dérive en effet du peuple par une concession et une institution positive et volontaire ; il ne peut être autre que ce que la concession positive a transmis, qui n’était que de faire des lois et non de faire des législateurs ; le législatif ne peut donc détenir le pouvoir de transférer l’autorité qu’il a de faire des lois, ni de la confier en d’autres mains. » Locke, John. Le Second Traité du gouvernement, trad. par Jean-Fabien Spitz, Paris, PUF, 1994, p. 141
[11] Le fait majoritaire est moins relatif au vote lui-même qu’à la présence d’une même volonté chez une majorité de citoyens. Il s’agit de la volonté la mieux partagée après soustraction des volontés divergentes. Voir Rousseau, Jean-Jacques. Œuvres Complètes III, [O.C].Ed. par de Bernard Gagnebin et Marcel Raymond, Paris, Gallimard (Coll. Bibliothèque de la Pléiade), 1964 p. 368 et 371
[12] Kelsen, Hans. La démocratie. Sa nature. Sa valeur, Paris, Dalloz, 2004, p. 26-29
[13] Constant, Benjamin. Principes de politique, Guillaumin, Paris, 1872 [En ligne]
[14] Arendt, Hanna « Qu’est-ce que la liberté ? » dans La crise de la culture, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1972, p. 212-214
[15] Rousseau, O.C., III, p.936-937
[16] Rousseau, O.C., III, p. 306
[17] Adam Smith énonce dans l’Enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations, livre IV, chap. II, (1776), traduction de Germain Garnier, Paris, Guillaumin et Cie, 1859, p. 209 [PDF en ligne] : « Tout en ne cherchant que son intérêt personnel, il (l’individu) travaille souvent d’une manière bien plus efficace pour l’intérêt de la société que s’il avait réellement pour but d’y travailler ».
[18] Bernardi, Bruno. « Le droit de vie et de mort selon Rousseau : une question mal posée ? », dans Revue de Métaphysique et de Morale, 2003/1 (n°37), pages 89 à 106.
[19] Bernardi, Bruno. « Le droit de vie et de mort selon Rousseau : une question mal posée ? », dans Revue de Métaphysique et de Morale, 2003/1 (n°37), pages 89 à 106.
[20]Rousseau, O. C., III, p. 376-377
[21] Rousseau, O. C., III, p. 306 – Rousseau explique que les engagements qui lient le citoyen au corps social ne sont obligatoires que parce qu’ils sont mutuels.
[22] Rousseau, O. C., III, p. 377
[23] On envisage la contingence dans ce contexte comme la possibilité qu’un criminel condamné par exemple pour un meurtre prémédité et commis sans regret ni remord récidive. Ce qui fait peser sur l’ensemble de la société un risque fatal que Rousseau cherche à évacuer. La société ne peut mettre sur le même pied d’égalité la valeur de la vie d’un tel criminel et celle d’innocents que l’on pourrait potentiellement perdre en cas de récidive.
[24] Rousseau, O. C., III, p.877
[25] Rousseau, O. C., III, p.377
[26] La perfectibilité étant la faculté qu’à l’Homme de s’améliorer ou non, elle devient le lieu d’un choix, donc du libre arbitre. A partir de ce moment, l’homme devient responsable de ses choix et ne peut faire porter les conséquences de ces derniers sur la collectivité.
[27] Baumert, Renaud. « Kelsen, lecteur critique de Rousseau : de la volonté générale à la volonté collective. » dans Jus Politicum – n°10 – 2013. [PDF en ligne]
[28]Rousseau, O. C., III, p.368 et 371
[29]Rousseau, O. C., III, p. 371
[30] Rousseau, O. C., III, p. 372
[31] Kelsen, Hans. La démocratie. Sa nature. Sa valeur, Paris, Dalloz, 2004, p. 71-72
[32] Voltaire avait traité Rousseau de « fou méchant », voir Voltaire, Correspondance choisie, Paris, Librairie générale française, 1990, p. 975
[33]Rousseau, Jean-Jacques. Deuxième dialoguede Rousseau juge Jean-Jacques dans Dialogues, Rêveries du promeneur solitaire, Correspondance, Paris, Librairie Larousse, 1972, p. 13-14
[34]Rousseau, O. C., III, p. 364
[35] Habib, Claude. Contradictions de Rousseau, article publié sur le site internet du Centre Rousseau de l’université Sorbonne Nouvelle, [En ligne].
Bibliographie
Cassirer, Ernst. Le problème Jean-Jacques Rousseau, Paris, Fayard/Pluriel, 2010.
Talmon, Jacob. Les origines de la démocratie totalitaire, Paris, Calmann-Lévy, 1966.
de Staël, Germaine. Lettres sur les écrits et le caractère de Jean-Jacques Rousseau, Paris, Editions Paléo, 2014.
Chateaubriand. Atala- René, Paris, Ed. Flammarion, 1964.
de Senancour, Etienne. Obermann, Paris, Ed. Champion, 2003.
Stendhal. Souvenirs d’égotisme, Paris, Gallimard, 1983.
Rousseau, Jean-Jacques. Les Confessions, Lipsic, 1804, [PDF en ligne].
Locke, John. Le Second Traité du gouvernement, trad. par Jean-Fabien Spitz, Paris, PUF, 1994.
Rousseau, Jean-Jacques. Les Rêveries du promeneur solitaire, dans Dialogues, Les Rêveries du promeneur solitaire, Correspondance, Paris, Librairie Larousse, 1972.
Rousseau, Jean-Jacques. Œuvres Complètes III, [O. C].Ed. par de Bernard Gagnebin et Marcel Raymond, Paris, Gallimard, (coll. Bibliothèque de la Pléiade), 1964.
Kelsen, Hans. La démocratie. Sa nature. Sa valeur, Paris, Dalloz, 2004.
Constant, Benjamin. Principes de politique, Paris, Guillaumin, 1872 [PDF en ligne]
Arendt, Hanna. « Qu’est-ce que la liberté ? » dans La crise de la culture, Gallimard, coll. « Folio », 1972.
Smith, Adam. L’Enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations (1776), traduction de Germain Garnier, Paris, Guillaumin et Cie, 1859. [PDF en ligne]
Bernardi, Bruno. « Le droit de vie et de mort selon Rousseau : une question mal posée ? », dans Revue de Métaphysique et de Morale, 2003/1 (n°37), pages 89 à 106.
Baumert, Renaud. « Kelsen, lecteur critique de Rousseau : de la volonté générale à la volonté collective. » dans Jus Politicum – n°10 – 2013. [PDF en ligne].
Voltaire, Correspondance choisie, Paris, Librairie générale française, 1990.
Habib, Claude. Contradictions de Rousseau, article publié sur le site internet du Centre Rousseau de l’université [en ligne].
-
 French Class – November 2022$40.00
French Class – November 2022$40.00